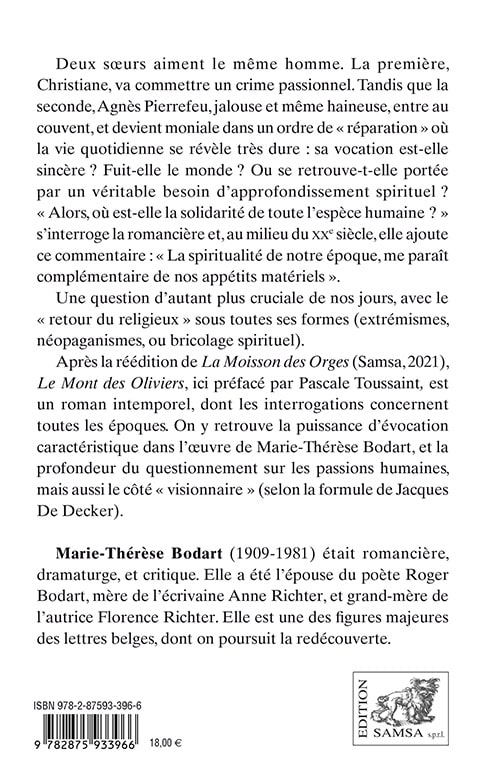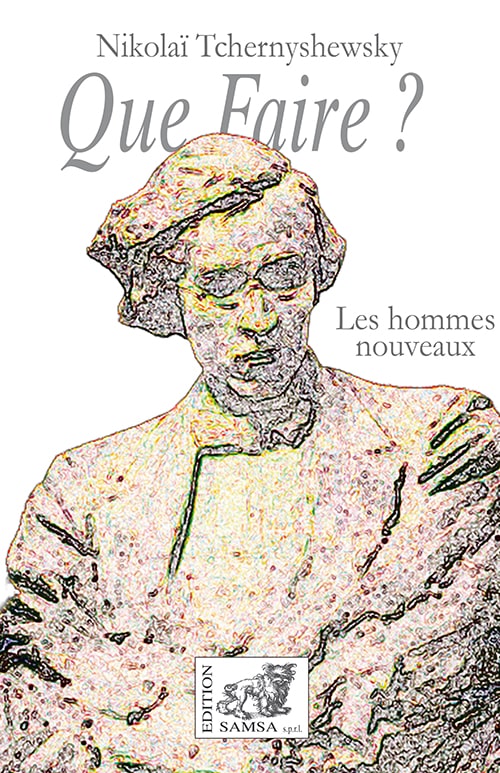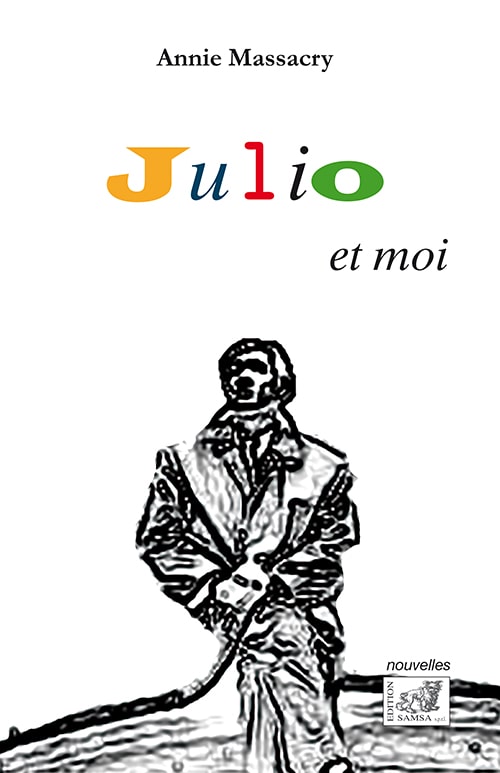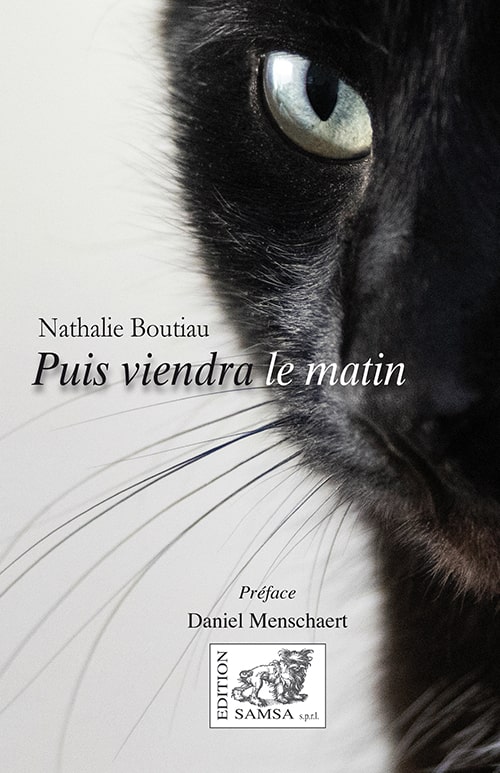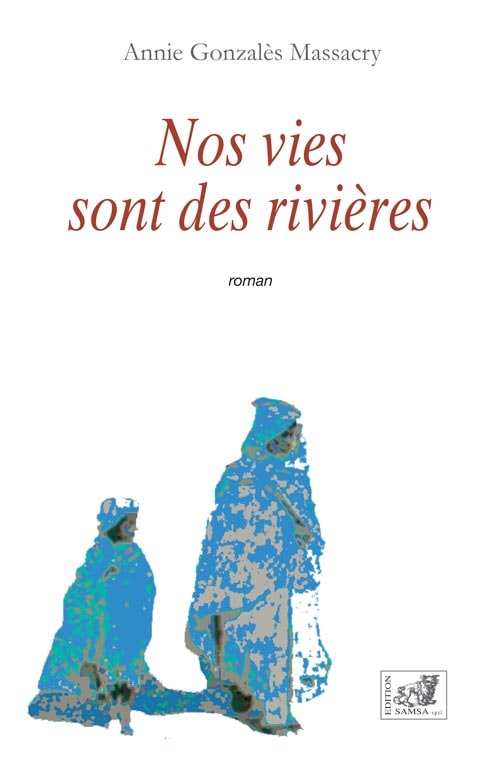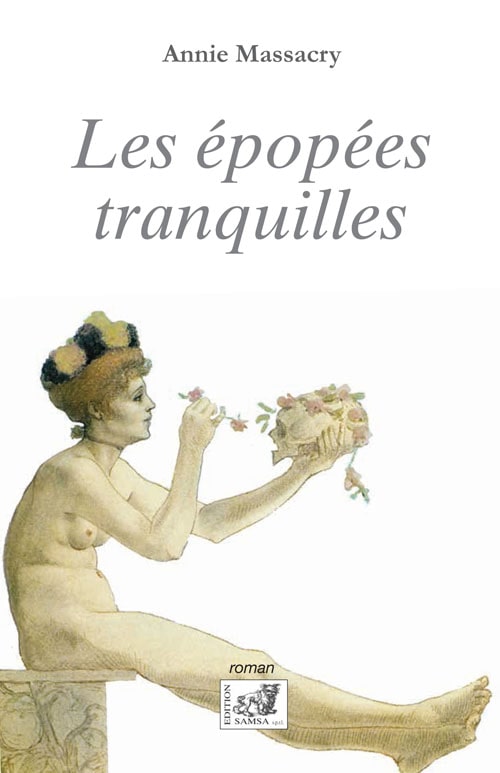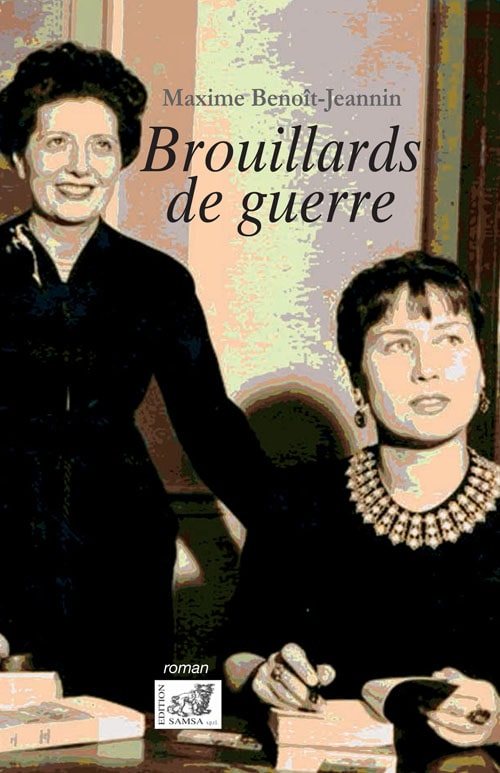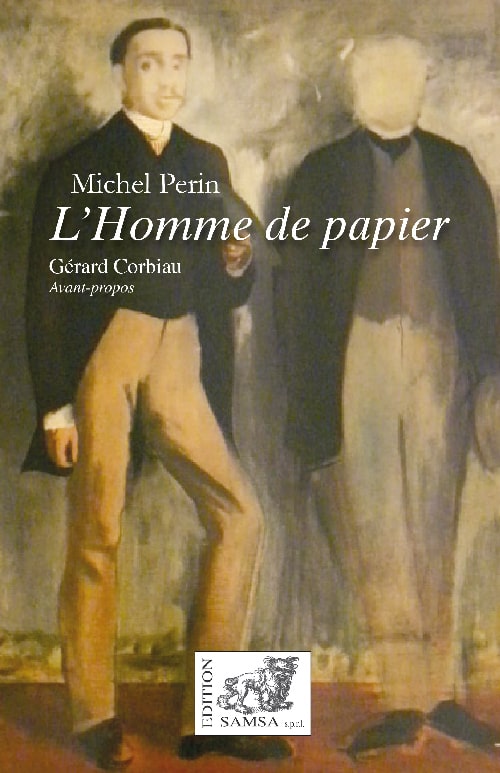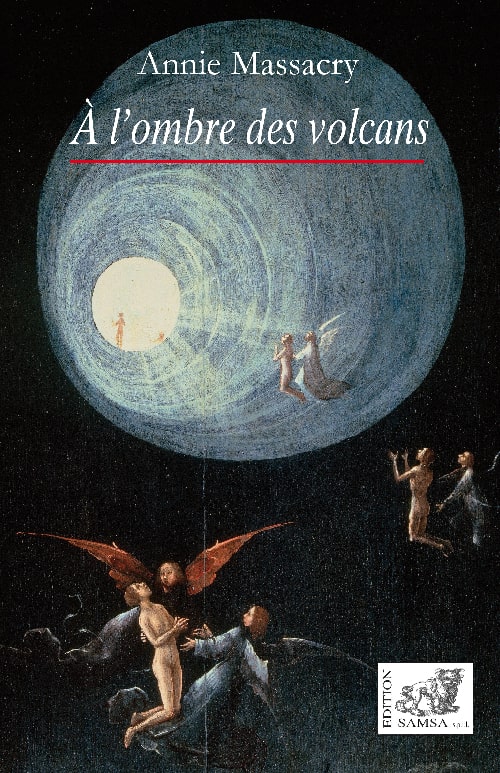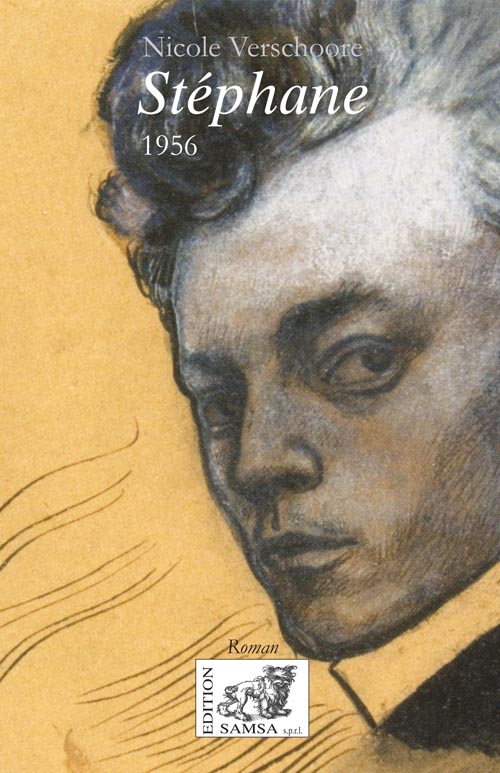Le Mont des Oliviers

Deux sœurs aiment le même homme. La première, Christiane, va commettre un crime passionnel. Tandis que la seconde, Agnès Pierrefeu, jalouse et même haineuse, entre au couvent…
Disponibilité: En stock
Deux sœurs aiment le même homme. La première, Christiane, va commettre un crime passionnel. Tandis que la seconde, Agnès Pierrefeu, jalouse et même haineuse, entre au couvent, et devient moniale dans un ordre de « réparation » où la vie quotidienne se révèle très dure : sa vocation est-elle sincère ? Fuit-elle le monde ? Ou se retrouve-t-elle portée par un véritable besoin d’approfondissement spirituel ? « Alors, où est-elle la solidarité de toute l’espèce humaine ? » s’interroge la romancière et, au milieu du xxe siècle, elle ajoute ce commentaire : « La spiritualité de notre époque, me paraît complémentaire de nos appétits matériels ».
Une question d’autant plus cruciale de nos jours, avec le « retour du religieux » sous toutes ses formes (extrémismes, néopaganismes, ou bricolage spirituel).
Après la réédition de La Moisson des Orges (Samsa, 2021), Le Mont des Oliviers, ici préfacé par Pascale Toussaint, est un roman intemporel, dont les interrogations concernent toutes les époques. On y retrouve la puissance d’évocation caractéristique dans l’œuvre de Marie-Thérèse Bodart, et la profondeur du questionnement sur les passions humaines, mais aussi le côté « visionnaire » (selon la formule de Jacques De Decker).
Le Mont des Oliviers
- 160 pages
- Dimensions : 140x205 mm mm
- Type : livre
- Couverture : softcover
- Poids : 0,300
- ISBN : 978-2-87593-396-6
- Maison d'édition : SAMSA Editions
Marie-Thérèse Bodart
Marie-Thérèse Bodart (1909-1981) était romancière, dramaturge, et critique. Elle a été l’épouse du poète Roger Bodart, mère de l’écrivaine Anne Richter et grand-mère de l’autrice Florence Richter. Elle est enfin une des figures majeures des lettres belges, dont on poursuit la redécouverte. Marie-Thérèse Bodart a tenu une importante chronique littéraire dans la revue internationale Synthèses. Son œuvre est rééditée chez Samsa édition.
Dernières parutions
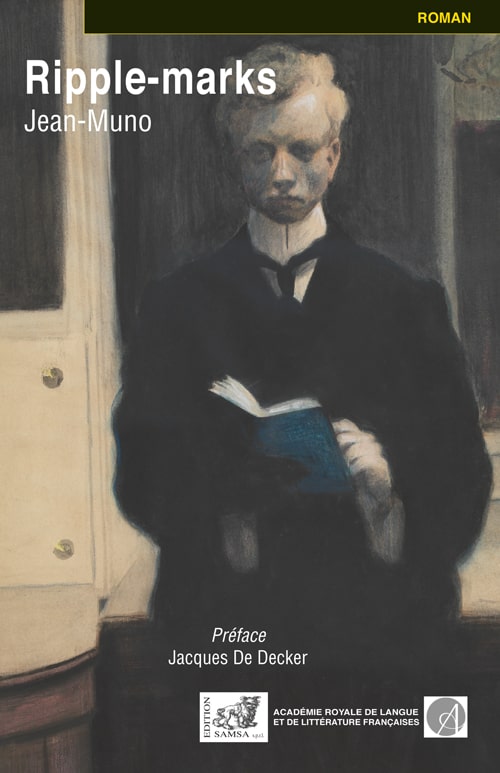
Ripple-marks (1976) est peut-être le plus grave des livres de Muno.
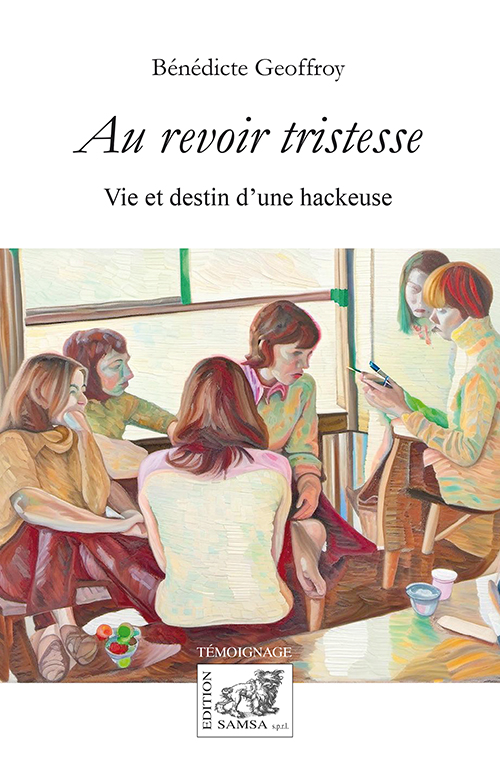
La Hackeuse finira par se faire prendre par la gendarmerie française à l’issue d’une course poursuite… Mais qui aura le dernier mot sur ce parcours et ce destin incroyables ? La Justice ? La Prison ? La famille ? L’argent ?
Tout le monde devrait lire Bénédicte Geoffroy, elle souffle un vent dynamique de courage et d’imagination qui nous aident à affronter une réalité qui, de nos jours, devient de plus en plus contraignante.